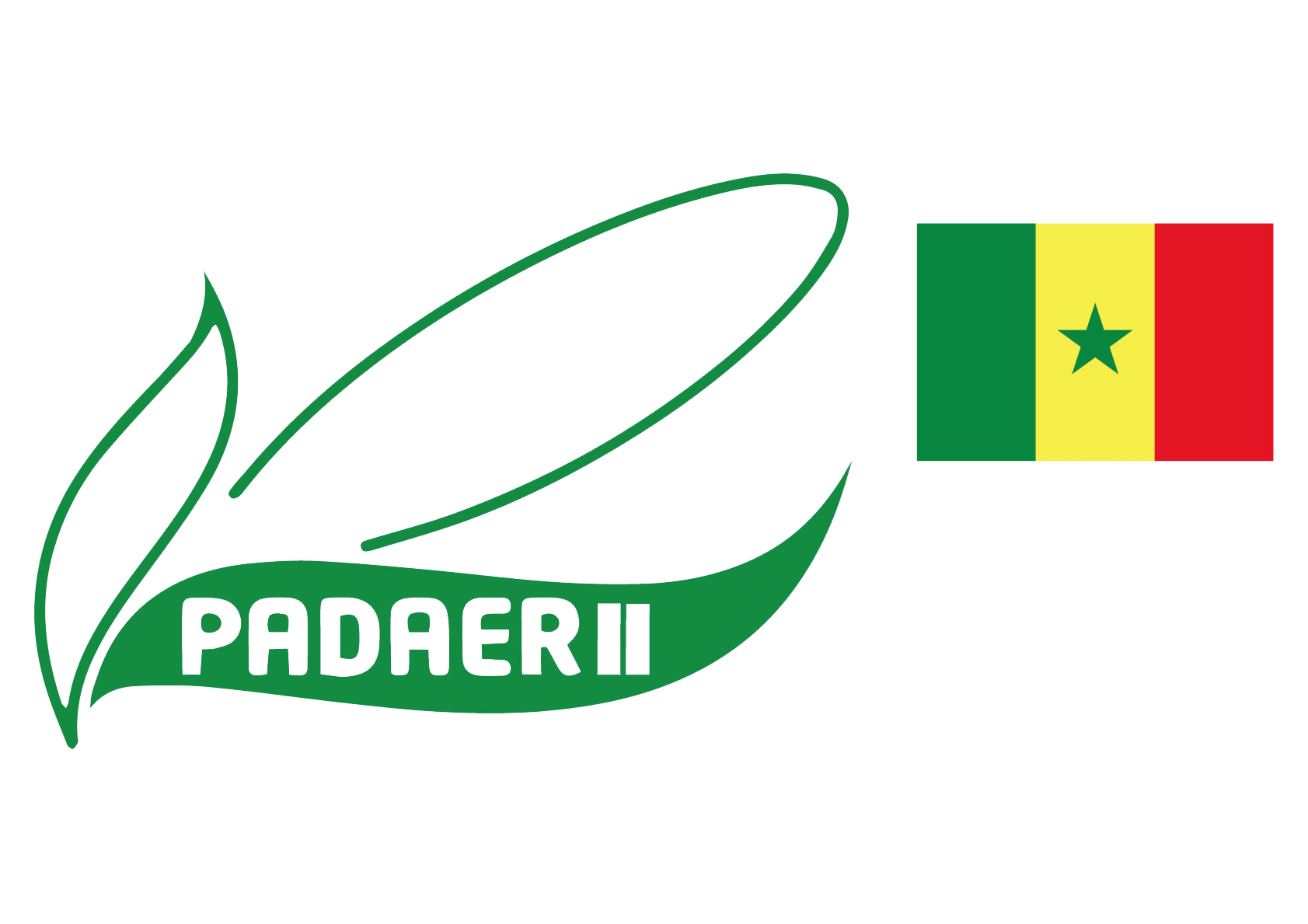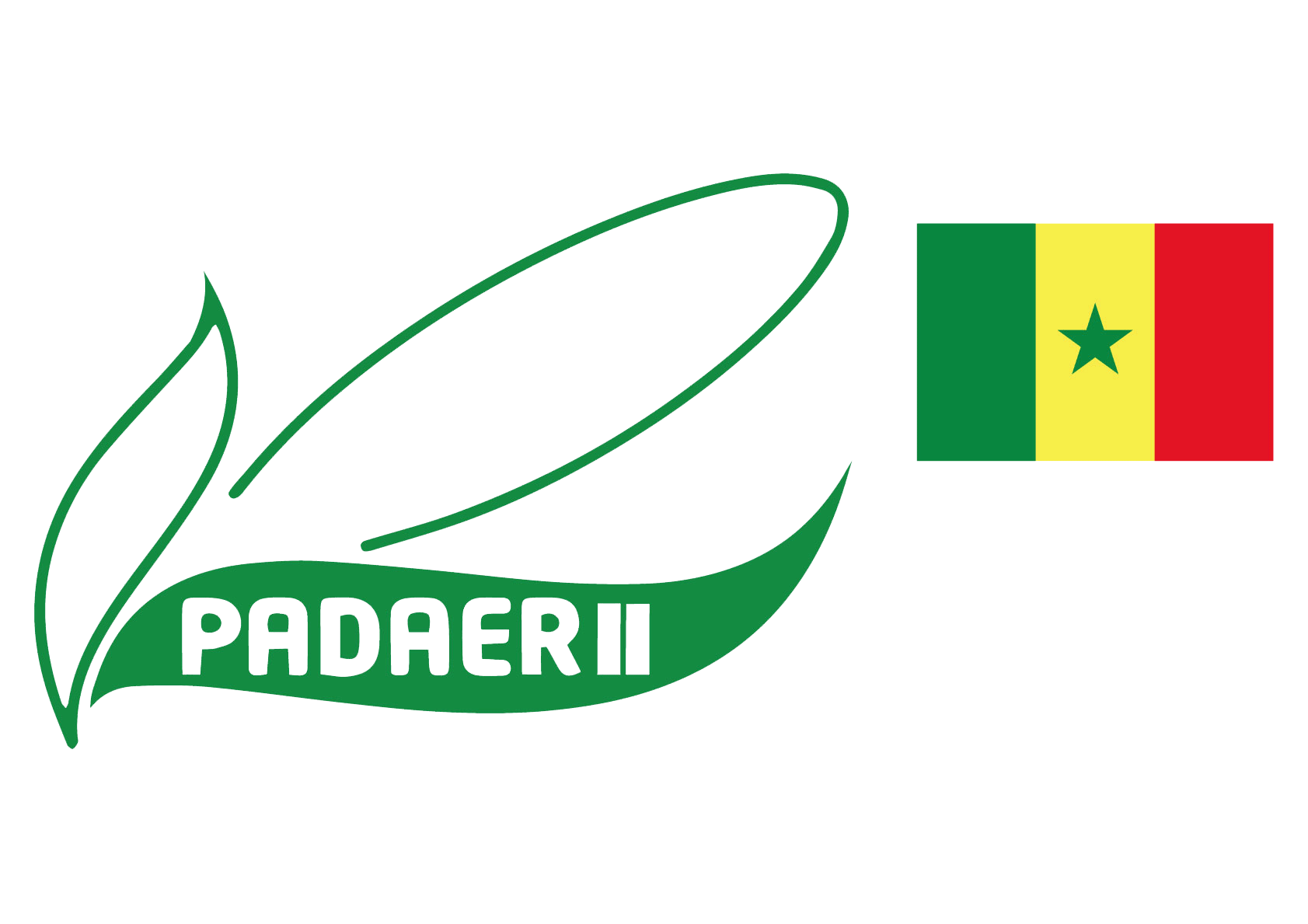- padaer2@padaer2.sn
- Quartier Liberté, Lot 184 Tambacounda
Composante B: Développement des filières et financements des acteurs
Sous-composante B1 : Développement et structuration des filières
Les objectifs de cette sous–composante sont de : (i) professionnaliser les OPB et OPF ; (ii) de faciliter l’accès aux marchés des marchés et éleveurs à travers la contractualisation entre les OP et des opérateurs de marché (OM) (commerçant, artisan-transformateur, agro-industriel, exportateur, structure hôtelière, MPER, etc.) ; et (iii) d’appuyer sur la concertation entre les acteurs des filières à travers des plateformes filières (tables filières et interprofessions).
Une vaste campagne de sensibilisation, d’information et de communication seront organisés avec les OP en collaboration avec les cadres locaux de concertation, les conseillers agricoles des partenaires stratégiques, les services décentralisés et déconcentrés de l’État, les chambres consulaires et les programmes en cours d’exécution dans la zone du projet. Elle aura pour but d’informer les bénéficiaires et les partenaires potentiels sur l’objectif, l’approche, les opportunités et les modalités de participation aux activités du PADAER-II. Elle ciblera l’ensemble des 600 OP et 30 OPF avec un accent particulier sur l’accès à la terre et la participation des jeunes et des femmes au Programme.
Professionnalisation et autonomisation des OP . Pour chaque OP porteuse de sous-projet, il sera organisé un Diagnostic institutionnel participatif (DIP) afin de déterminer les capacités organisationnelles, les contraintes et les besoins d’appui spécifiques et de renforcement des capacités des OP dans une perspective d’autonomisation durable. Les membres de l’OPF des TF sollicitant des demandes au programme seront également déclenchés et un plan d’action de renforcement institutionnel et économique (PARIE) élaboré afin de renforcer leurs faîtières notamment dans la prise en charge des questions de services économiques aux accès aux OPB ( durable aux intrants, la commercialisation, la recherche d’OM partenaires…etc.).
La stratégie d’appui aux OP s’appuie sur le modèle « Autonomisation des Organisateurs de Producteurs » (AOP) qui s’articule autour d’une stratification organisationnelle des OP en trois niveaux : les Stades d’Autonomie Organisationnelle (SAO). A chaque stade correspondra un appui adapté de manière à faire évoluer une masse critique d’OP des niveaux 1 et 2 vers le niveau 3 qui correspond à l’autonomie et à la professionnalisation. Cette approche testée, validée et mise en œuvre par le PRODAM a produit des résultats tangibles sur le terrain. Le PADAER-II appuiera au total 600 OP et 30 OPF dans les quatre régions d’intervention.
Le renforcement des OP comprendra trois volets. Un premier volet portera sur le renforcement des capacités dans la gouvernance : formation des dirigeants à leurs rôles respectifs (les président(e)s, secrétaires et trésorier(e)s ainsi que leurs adjoints, soit 6 membres de bureau par OPB seront ciblés soit au total 3600 bénéficiaires), ainsi que sur le fonctionnement de la vie associative. De plus, les 600 OPB et 30 OPF bénéficient de l’appui dégressif du Programme pour la supervision des assemblées générales. Les CADL, partout où leur dispositif le permettra, seront sollicités pour suivre la mise en œuvre des plans d’actions des OP et des PARIE des OPF.
Un effort particulier sera porté sur le renforcement du leadership par les femmes et les jeunes dans les OP à travers des activités de formation et des visites d’échanges. La présence des femmes et des jeunes dans les OPB et les OPF figure parmi les indicateurs d’évaluation des stades d’autonomie organisationnelle (SAO).
Un deuxième volet sera l’appui des capacités financières et de gestion des OP. Il s’agit notamment de : (i) évaluer les capacités de financement des OP porteuses des sous projets du Programme ; (ii) l’élaboration, la formation et le suivi évaluation des plans d’actions des PO ; (iii) la formation sur la connaissance de l’environnement des affaires des OP et le développement de partenariats ; la formation en éducation financière ; (iv) la formation et l’élaboration des états financiers des PO ; et (v) le contrôle de la gestion des activités économiques des OP.
Un troisième volet comprendra les activités de renforcement institutionnel des OPs, notamment: (i) la réalisation ou la réactualisation des plan d’actions et des PARIE ; (ii) la structuration des OPB et OPF; (iii) le renforcement institutionnel des unions et des fédérations ;; (iv) l’évaluation du niveau de maturité des OPB. Cette activité importante, qui n’a pas été bien exécutée par les partenaires stratégiques dans la première phase, sera dans le cadre du PADAER-II exécutée en collaboration avec FONGS, l’Asprodeb et les services déconcentrés de l’État notamment les services régionaux d’appui au développement communautaire (SRADC) et les services régionaux d’appui au développement local (SRADL).
Contractualisation entre les organisations de producteurs (OP) et les opérateurs de marché (OM). Parallèlement au programme de renforcement institutionnel des OP, le Programme visa à appuyer leur capacité de lien au marché grâce aux contrats entre celles-ci et les OM ayant pour but de (i) sécuriser l’accès des producteurs à un marché plus rémunérateur; (ii) garantir un approvisionnement en quantité et en qualité des OM; (iii) servir de levier pour faciliter l’accès des acteurs des filières notamment les producteurs, les OP et les OM aux financements ; et (iv) inciter le secteur privé à investir dans l’agriculture durable , résiliente et compétitive.
Sur la base des expériences réussies du PAFA, du projet Naatal Mbay sur financement del’USAID, du PADAER I et du PAFA-E, le PADAER-II facilitera la mise en relation durable entre les OP et les OM suivant la démarche comprenant les étapes suivantes: (i) organisation des campagnes d’information et de sensibilisation des acteurs des filières agricoles et d’élevage sur les opportunités, l’approche et les modalités de la contractualisation OP-OM dans toutes les communes ciblées, avec la participation des producteurs et éleveurs, des OM, des représentants des jeunes et des femmes, des autorités locales, des services techniques déconcentrés, des ONGs, des notables, des chefs religieux et les représentants de la société civile; (ii) élaboration des répertoires d’OM actifs (locaux, nationaux, et internationaux) dans les filières soutenues, solvables et intéressés par la constitution de couples OP-OM; (iii) appuis des séances et des tournées de négociation (quantité, qualité, modalités de livraison et de paiement) entre OP-OM; (iv) appuis à la préparation des contrats qui devront être conclus avant le démarrage de la campagne de production et contenant certains éléments tels que les mécanismes de fixation des prix, le volume, la durée du contrat, les normes qualité, les modalités de paiement et de collecte, ainsi que les règles applicables en cas de force majeure ; (v) organisation en relation avec les chambres consulaires et les interprofessions des sessions de formation des OP et des OM et des visites d’échange sur la contractualisation commerciale ; et (vi) appuis au suivi et à la gestion d’éventuels conflits dans la mise en oeuvre des contrats OP-OM.
Le PADAER-II facilitera: (i) l’identification des OM solvables; (ii) l’organisation des ateliers et des tournées d’intermédiations commerciales entre OP et OM; (iii) l’identification des marchés de référence; (iv) l’élaboration des contrats de commercialisation sur la base des conditions claires et transparentes; (v) la diffusion d’informations sur les prix et les marchés ; ainsi les couples OP-OM partenaires du PADAER-II pourront être connectés au réseau Yegle développé dans le cadre du PAFA et géré par les cadres interprofessionnels ; et (vi) les missions de suivi et d’évaluation de l’exécution des contrats.
Une fois avoir facilité l’intégration des OP avec le marché, il est important que les filièressoient suffisamment structurées afin d’arriver à la création de chaines de valeurs. Des tables filières (TF) sont actuellement en phase de développement et de consolidation dans les filières riz, maïs, mil et sorgho, niébé, bissap et sésame avec l’appui du FNDASP, du projet Naatal Mbay et du PAFA-E. Le PADAER-II continuera la consolidation des plateformes existantes ou en phase de construction au niveau national sur les filières soutenues. Le Programme facilitera l’intégration des acteurs notamment les petits producteurs, les femmes et les jeunes de sa zone d’intervention dans les cadres interprofessionnels déjà existants ou en cours de construction au niveau national (riz, maïs et aviculture). Il appuiera la mise en place de tables filières (TF) pour les filières fonio, riz pluvial, aviculture villageoise, maïs et petits ruminants dans sa zone d’intervention. Les TF permettront de garantir la concertation entre les acteurs des filières et la participation effective des petits producteurs, des jeunes et des femmes à la gouvernance des filières et au dialogue politique. Le Programme recherchera un lien entre les TF et les cadres interprofessionnels au niveau national qui existent déjà et qui sont crédibles. Les tables filières en collaboration avec les chambres consulaires (chambres de commerces, les chambres de métiers et les chambres d’agriculture) seront au centre du dispositif d’appui à la contractualisation OP-OM.
Cette approche favorisera une gouvernance collaborative des filières, la transparence et la structuration de l’offre pour répondre à la demande du marché. Elle s’appuiera sur la mise en œuvre des activités suivantes: (i) la réalisation des études approfondies des filières retenues; (ii) la mise en place de tables filières regroupant les acteurs clés notamment les producteurs, les fournisseurs d’intrants, les transformateurs, les commerçants, les MPER les institutions financières, l’assurance agricole, les chambres consulaires, les prestataires de services, les partenaires stratégiques et les institutions de recherche; (iii) la préparation des plans stratégiques de développement filière sur quatre ans et des plans d’action annuels par filière;(iv) l’animation des tables filières ; (v) le suivi de la mise en oeuvre des plans d’action annuels par filière ; et (vi) le renforcement des capacités des OPB/OPF/OM qui devront conduire à leur professionnalisation par l’accroissement de leur performance institutionnelle et leur compétence organisationnelle, technique, de gestion et commerciale.
Le PADAER-II facilitera : (i) l’acquisition de siège fonctionnel aux TF; (ii) l’élaboration et l’exécution des plans stratégiques de développement par filière et des plans d’action annuels par filière; (iii) la mise en place de TF fonctionnelle dotée de commissions techniques opérationnelles; (iv) le renforcement des capacités des membres des TF; (v) l’actualisation des plans stratégiques et des plans d’action; et (vi) le suivi et l’évaluation des plans. À partir de la quatrième année et selon le degré de maturité des TF, s’il n’existe pas encore de cadres interprofessionnels crédibles sur les filières soutenues, le PADAER-II facilitera l’évolution des tables filières en cadres interprofessionnels filière au niveau national à l’exemple de la mise en oeuvre du PAFA et conformément à la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale. Durant les trois premières années de mise en œuvre du PADAER-II, un prestataire spécialisé par filière accompagnera la structuration des filières et le processus de contractualisation OP/OM.
Sous-composante B2 : Entreprenariat rural
L’objectif de la sous composante est d’appuyer l’émergence de 110 PMER viables . L’auto-ciblage est orienté vers des initiatives portées par des jeunes et des femmes ayant au préalable acquis des formations initiales sanctionnées par des titres de qualification et des capacitations techniques certifiées. Les tables filières valideront le type de MPER proposé et leur potentiel de marché.
A titre indicatif , le PADAER-II appuiera l’émergence des initiatives suivantes :
– Mise en place d’unités de transformation multifonctionnelles de produits locaux . Les activités de valorisation portées par les femmes seront développées dans des Hub de transformation qui abriteront 80 PMER.A la différence des unités individuelles éparpillées construites dans le cadre des PROMER-1, PROMER-2 et PADAER-1, ces unités sont constituées pour (a) rationaliser les infrastructures d’appui mises à la disposition des MPER, (b) optimiser les capacités de production, (c) veiller sur les normes d’hygiène et de qualité des produits, et (d) construire les bases des différents réseaux des filières. Aussi, ils peuvent générer des activités entrepreneuriales grâce à l’exploitation des équipements et machines de transformation aux normes qui seront installés.
– Mise en place des coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) . Il s’agit d’activités organisées autour de 16 MPER de prestations de services de matériels agricoles, pouvant mobiliser des jeunes regroupés.Ces activités peuvent prendre la forme de CUMA avec le modèle initié par la SAED dans la zone de Matam, ou les groupements de jeunes prestataires de services développés par le PADAER dans les zones de Kolda et de Kédougou. Ces CUMA sont dirigées de matériels et d’équipements. Chaque CUMA dispose d’un hangar pour abriter les différents équipements.
-Promotion du 14 PMER de fabrication de machines et équipements agricoles portées par des jeunes issus des centres de formations techniques et ayant reçu des titres de qualification certifiés. Il peut aussi agir de MPER existant justifiant d’un dynamisme avéré et ne faisant pas partie de la génération des PROMER 1 et 2. marchés de l’État en matière de fourniture de machines agricoles.
Techniques de capacitation . Le paquet d’appui non financiers capitalize la démarche du 78.PADAER en mettant l’accent sur un meilleur ciblage, la mise en marché et la commercialisation des produits (renforcement du packaging, pénétration massive des circuits modernes de distribution de masse y compris à l’export), la certification et la labellisation. Ce travail sera soutenu par des conseillers de proximité et des cabinets spécialisés et des agents techniques ayant des compétences transversales. L’outil de base est le plan d’affaires pour les 110 MPER qui, une fois conçu sur la base d’une étude prospective de développement sur le tribunal, moyen et long terme, devra indiquer l’ensemble des activités à mener.L’ADEPME facilitera la formation de personnes ressources sur la technique d’élaboration et de suivi de la mise en œuvre des plans d’affaires au niveau de la zone d’intervention. Les ONG locales peuvent également être dans le processus de préparation et de suivi des plans d’affaires. La mise en œuvre se fera en partenariat avec l’ADEPME avec à la clé la mobilisation du fonds à frais partagés qui a pour objectif d’assister les entreprises privées à améliorer leur compétitivité et leur croissance par un accès aux services d’experts susceptibles de contribuer à la mise à niveau desdites entreprises (consultations, formations…).Il accorde aux entreprises sélectionnées des subventions, entre 50 et 75 %, en vue de leur permettre de se développer, d’améliorer leur compétitivité et de réaliser des gains de croissance. De façon indicative, les formations concernent les domaines suivants : (i) la culture d’entrepreneur qui cible le maximum de jeunes ; (ii) la formalisation d’entreprises ; (iii) l’éducation financière ; (iv) la transformation de fruits et légumes et de céréales locales ; (v) la fabrication de machines et équipements agricoles et de post-récoltes ; (vi) la conduite des moteurs et à l’exploitation des outils et matériels agricoles et post-récoltes lourds ;(vii) l’incubation à l’intérieur des fermes d’embouche et des mini-fermes de production laitière. Les sessions de formations vont toucher au moins 550 entrepreneurs dont 70% des jeunes (deux sexe ) et 30 de femmes. (iv) la transformation de fruits et légumes et de céréales locales ; (v) la fabrication de machines et équipements agricoles et de post-récoltes ; (vi) la conduite des moteurs et à l’exploitation des outils et matériels agricoles et post-récoltes lourds ; (vii) l’incubation à l’intérieur des fermes d’embouche et des mini-fermes de production laitière. Les sessions de formations vont toucher au moins 550 entrepreneurs dont 70% des jeunes (deux sexe ) et 30 de femmes.(v) la fabrication de machines et équipements agricoles et de post-récoltes ; (vi) la conduite des moteurs et à l’exploitation des outils et matériels agricoles et post-récoltes lourds ; (vii) l’incubation à l’intérieur des fermes d’embouche et des mini-fermes de production laitière. Les sessions de formations vont toucher au moins 550 entrepreneurs dont 70% des jeunes (deux sexe ) et 30 de femmes.
Commercialisation des produits . Les appuis en centres commerciaux et de mise en marché des produits de promotion commerciale seront conduits par des prestataires spécialisés qui assureront la charge d’identifier les circuits appropriés, de négocier des contrats et de bâtir au profit du MPER des relations commerciales durables notamment avec les grandes surfaces. Plusieurs autres services seront fournis aux MPER pour accompagner leur graduation d’un niveau à l’autre. Ces services concernent, entre autres, l’organisation de visites d’échanges, l’appui à la participation à des foires et expositions, la mise en réseau, l’appui à la conception de plans de commercialisation.Le Programme facilite l’adhésion des MPER au supermarché des produits locaux mis en place par la Coopérative des transformateurs appuyés par le PAFA-E.
Coaching de proximité . Le conseil de proximité sera soutenu par les intervenants ayant travaillé avec le PADA avec une qualité des interventions déjà jugée satisfaisante. Ils deviendront prioritaires pour établir un vivier de fournisseurs potentiels de conseils d’établissement de profils à partir de la formation initiale adaptée et en ressortissant des zones d’intervention du Programme.Des sessions de formation seront organisées pour 25 conseillers de proximité et de relais pour les MPER sur des thématiques variées en rapport avec les besoins des MPER en vue de bâtir une relation de fourniture de services durable: méthode de diagnostic, montage de plan d’affaires , méthode de coaching de petites entreprises, recherches de méthodes commerciales, la comptabilité, les bases de données montage de dossiers de financement, etc.
Sous-composante B3 : Financements des acteurs des filières
Le financement rural vise l’amélioration de l’accès à des financements des petits producteurs agricoles et éleveurs à court, à moyen et à long termes en opérant la connexion indispensable entre la subvention dégressive, l’épargne intrants et le crédit auprès des institutions de financement. La demande est essentiellement caractérisée par une insuffisance dans sa structuration, le niveau de culture économique et financière faible des demandeurs ainsi que le risque élevé du secteur de l’agriculture.
Le PADAER-II mettra en place le mécanisme de financement qui s’articulera autour de trois mécanismes :
– Le mécanisme de la subvention dégressive des intrants qui sera maintenu mais aux taux de 80%, 60% et 40%. Il sera accompagné par une campagne d’information et de sensibilisation des OPB et OPF sur l’épargne et le crédit, la signature de conventions de partenariats avec les institutions de financement dans la zone du Programme et un renforcement institutionnel des OP et OPF. La connexion entre la subvention dégressive et le financement externe sera une démarche privilégiée dans la mise en oeuvre de PADAER-II. En effet, dès la première année de financement des Spam, l’apport des OP sera financé d’au moins à 50% par un crédit bancaire. Les conventions de financement des SPAM seront ainsi financées de matière tripartite entre OP, IF et Padaer-II. Pour la première année: Apport OP (10%), crédit bancaire (10%) et Padaer-II (80%). Pour la deuxième année Apport OP (20%), crédit bancaire (20%) et Padaer-II (60%). Pour la troisième année: Apport OP (30%), crédit bancaire (30%) et Padaer-II (40%). Globalement les apports des OP pour le financement des sous projet seront de 20% pour la première année, 40% pour la deuxième année et 60% pour la troisième année. A partir de la quatrième année, Les Op vont financier a 100% les besoins en intrants des membres à travers le crédit bancaire et l’épargne. Pour les équipements ( machines, matériels). La subvention accordée variera entre 40% à 50% du montant de la demande de financement. L’apport des Op à travers, un crédit bancaire sera de 50% à 60%.
– L’épargne-intrants en nature ( Apport en nature) : c’est un dépôt de chaque membre d’OP équivalent en nature à ses besoins en intrants pour préparer la campagne agricole qui est vendu par l’OP à l’OM ( contrat de vente production). La somme récoltée servira comme apport pour la subvention de l’année qui suit et la mobilisation de financements externes. Le PADAER-II maintiendra ce mécanisme avec la domiciliation des apports dans les comptes bancaires des OP ; ce qui permettra aux institutions de financement de se faire une opinion sur la solvabilité des OP lors de leurs demandes de crédits.
– Le dispositif de financement externe qui sera axé sur la synergie existante entre les institutions intervenant dans l’offre. En effet, pour des questions de durabilité, d’efficacité et de maitrise des coûts du crédit, le PADAER-II promouvra les mécanismes de financement ayant déjà fait leurs preuves notamment avec le FADSR, le FONSTAB et le FONGIP. La mise en œuvre du partenariat avec ces fonds de refinancement se fera selon les deux étapes suivantes: la signature de conventions et le Suivi-évaluation de la mise en oeuvre.
Liens rapides
Autres Pages
Infos de contacts
- Tambacounda, Quartier Liberté, lot 184 - BP 158
- +221 77 450 04 44
- padaer2@padaer2.sn
A propos de nous
Le PADAER II est mis en œuvre par l’Etat du Sénégal avec l’appui du FIDA, la Coopération Espagnole, OFID